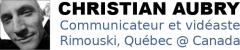Après la société de consommation, viendrait la société des loisirs. Vous vous souvenez? C’était vers la fin des années 80. Un vent d’optimisme arborant le sourire éclatant de Ronal McReagan nous promettait des lendemains qui allaient chanter le calme, le luxe, la volupté. Quinze ans après, on trime toujours comme des boeufs. Même que cela empire, la pression taureaumachique affectant de plus en plus le troupeau.
Après la société de consommation, viendrait la société des loisirs. Vous vous souvenez? C’était vers la fin des années 80. Un vent d’optimisme arborant le sourire éclatant de Ronal McReagan nous promettait des lendemains qui allaient chanter le calme, le luxe, la volupté. Quinze ans après, on trime toujours comme des boeufs. Même que cela empire, la pression taureaumachique affectant de plus en plus le troupeau.
Pourtant, je ne me plains pas. Je travaille au moins 45 heures par semaine (payé 35), mais j’aime ça. La plupart des mes loisirs sont d’ailleurs consacrés à des activités « para-laborieuses », ce qui fait qu’en fait je travaille directement ou indirectement un bon 60 heures — et plus, vous dirait ma conjointe. Il faut dire que les réseaux d’ordinateurs constituent une drogue dure et que j’en suis accroc. Je ne fais plus très bien la différence entre travail, formation et détente.
Mes « ordis » sont les planètes d’un univers virtuel dans lequel je gravite en état d’apesanteur sociale. Mon portable, par exemple, est à la fois un bureau mobile, un atelier de formation, une chaîne Hi-Fi, un laboratoire photo, une table de montage, une boîte à souvenir, un cinéma-maison, une salle de presse, un salon de thé virtuel, un téléphone, un visiophone, un bureau de poste, un journal « extime » et un raton laveur. Reste que je ne trouve pas sa voix particulièrement attrayante, que je lui parle d’ailleurs très peu et que nos rapports n’ont rien d’empathique.
J’ai bien entendu doté ma conjointe — signe hélas! trop extérieur de mon restant d’humanité — d’un fringuant « desktop » à écran plat que je bichonne comme une décapotable et grâce auquel je change à l’occasion ma tendinite de place. Les habitants des Gonaïves crèvent sous la boue, mais ma fille de 11 ans a son PC itou. Pour ces deux « femmes dans ma vie », il s’agit là, bien sûr, d’objets utiles et agréables, mais aussi — et surtout — des alibis douteux de mon évanescence.
Pour couronner le tout, j’élève avec passion un serveur Web multitâche (routeur, pare-feu, passerelle, boîte à lettres, engin de publication, entrepôt de données, alouette) qui me récompense chaque semaine par des heures de plaisir. Ensemble, nous partons à la pêche à la ligne de commande. Quand les programmes mordent à l’hameçon, je suis heureux comme un ourson.
Voilà donc ce qu’est pour moi la société des loisirs : un environnement de travail dont le médium est devenu le message, duquel je suis totalement dépendant et auquel j’abandonne, avec une volupté toute suicidaire, les sphères intimes de mon existence — y compris et surtout celle des loisirs. Je ne suis pas malheureux, bien au contraire. Je pourrais continuer à m’amuser ainsi jusqu’à l’épuisement.
Heureusement, tout le monde n’est pas comme moi. Nombreux sont celles et ceux qui trouvent ce genre de comportement exécrable. Je les comprend, mais je ne puis être tout à fait d’accord avec eux. Ma conjointe affirme que cette dérive artificielle n’aide pas à combattre l’érosion naturelle qui affecte sournoisement notre relation conjugale. Elle a raison. Sa propension à conjuguer celle-ci au mode passif fait cependant que je ne me sens pas trop coupable.
Et puis d’un autre côté, n’oublions pas que Dame Nature n’est pas tendre envers les humains. Elle n’a pas pour souci de nous rendre meilleurs, mais de maintenir les équilibres aveugles et cruels qui la régissent. En confondant loisir et travail, en virtualisant nos humaines passions, elle accomplit une oeuvre obscure mais salutaire. La société du travail-loisir-ordi est certes une plaie sociale, mais elle produit bien moins de surpopulation et de larmes que son ancêtre, travail-famille-patrie.